Le jargon de la réforme
L’éducation a des prétentions de science. Certains y arrivent effectivement, quoiqu’ils pèchent souvent par généralisation. Le praticien, pour sa part, compose avec les individus. Par conséquent, sa science se situe davantage dans la zone mouvante d’une recherche-action limitée que celle, plus définie, de la recherche empirique, la première s’inspirant de la dernière. Toujours est-il que dans l’émergence des sciences de l’éducation, un jargon professionnel a vu le jour. C’est un phénomène nécessaire, considérant le besoin de définir les concepts. Mais dans le désir d’affirmer notre science, nous avons multiplié indûment l’usage de termes abscons. Or, l’éducation n’est pas une science comme les autres, en ce qu’elle n’est pas seulement l’affaire des spécialistes : elle concerne tout autant les parents et la société.
Les éducateurs doivent apprendre à communiquer efficacement avec leurs partenaires, pour faire un clin d’oeil aux compétences transversales. Un vocabulaire simple garantit que le message sera décodé par le récepteur. Des termes tels que constructivisme, socioconstructivisme, question-guide, enseignement explicite ou affordance précisent la communication entre éducateurs, mais ils entravent celle auprès du public. Plutôt que de dire compétences transversales, on parlera de compétences générales ; à défaut d’être exacte, l’expression a le mérite d’être compréhensible.
Il semble que le MELS souffre du baragouin qui prévaut dans les tours d’ivoire. Les éducateurs n’ont pas été plus fins. La communication n’est pas seulement affaire de moyens, et encore moins de nouvelles technologies, mais de contenu et de forme. Par ailleurs, la réforme ne se joue pas essentiellement dans les mots, mais dans l’action éducative.
À tout le moins, on évitera que certaines expressions servent de boucs émissaires au changement. Je suis d’ailleurs étonné de constater le malin plaisir de certains journalistes à ridiculiser des concepts dont ils ignorent tout. C’est plus facile, sans doute, que de chercher à comprendre.
Fondamentalement, les mots doivent être au service de l’action, et non l’action défendre un mot, un concept, ou une théorie. Dans la querelle entre réformistes et conservateurs, j’ai souvent l’impression qu’on a effectivement inversé les rôles. On a encore eu droit à une échauffourée à la suite du billet de Mario qui réagissait à certaines attaques contre la réforme, notamment à la volte-face de Pauline Marois qui déclarait qu’elle en a maintenant marre d’entendre parler des « compétences transversales » (La Presse : Marois en a marre du jargon de la réforme). Parmi les commentaires inspirants qui ont alimenté le débat, j’aime particulièrement celui de Michel Le Neuf (# 16) :
Demain, il y aura encore des socioconstructivistes, des behavioristes, des tenants de l’enseignement explicite. Il y aura encore des éducateurs libertaires et aussi des traditionalistes, Il y en a qui vont s’enflammer pour la lecture syllabique, d’autres pour les approches globales. Mais au bout du compte, ceux qui auront droit à une place dans la lumière, ce sont ceux à qui le pouvoir tendra la main. Les constructivistes vont continuer de se voir dans la continuité historique du rationalisme de Platon, et trouver dans cette filiation une justification historique. Les autres vont se réclamer de l’empirisme d’Aristote et rien ne va se régler. Enfin, qu’auraient été Michel-Ange et Léonard sans l’or des mécènes?
Non, moi j’invite les éducateurs à tourner le dos à ce jeu disgracieux, à prendre le maquis, et à se concentrer sur ce qu’ils savent le mieux faire: faire apprendre. En politisant le débat, on a fait entrer le loup dans la bergerie. Regarder avec la lecture en France: c’est ce que ça donne quand on laisse les politiciens faire le travail à notre place.
Quant à la déclaration de Mme Marois, plutôt que de tomber à bras raccourcis sur la réforme, on devrait la féliciter d’admettre un impair de formulation. Personne n’est à l’abri des erreurs, surtout en période de profond bouleversement social. Seuls ceux qui ne font rien ne commettent pas d’erreur. Et puis, on n’a jamais prétendu que la réforme serait parfaite dès son lancement. Dans une perspective d’évolution, il y a toujours des obstacles à surmonter. Si on mettait autant d’énergie à construire la réforme qu’à la démolir, nous aurions contribué au progrès plutôt qu’à la stagnation. Encore une fois : mettre le mot au service de l’action.
Mise à jour, 4 avril 2007 | Lors du congrès de l’Association des enseignants et professeurs (Grande-Bretagne), deux enseignants s’apprêtent à faire un plaidoyer auprès de leurs collègues pour mettre un terme au jargon de la profession (BBC : Edu-babble’ jargon under attack). On semble surtout déplorer l’usage des acronymes.
Par ricochet :
Les affres de la réforme
Attaques contre la réforme
Un syndicat d’enseignants pour la réforme
L’école engendre-t-elle la résistance au changement ?
Regard intuitif sur la notion de compétence (Jobineries)
Compétences transversales dites-vous ? (École et société)
Vous pouvez suivre les commentaires en réponse à ce billet avec le RSS 2.0 Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback.

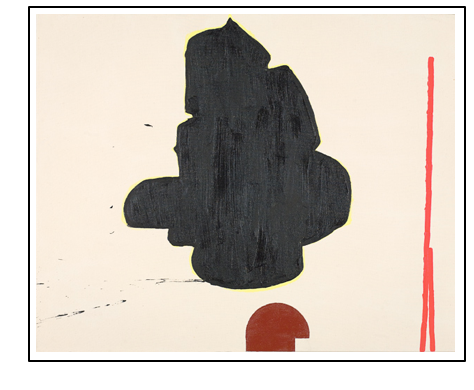
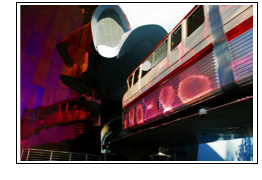

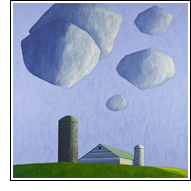

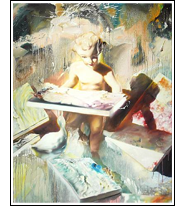


« la connaissance c’est le début de l’action : l’action l’accomplissement de la connaissance » c’est de Wang Yang Ming , philosophe et homme d’action qui soulignait à la fin du 15éme siécle que pensée et action ne faisaient qu’un.
Cela marche dans l’autre sens également: « l’action, c’est le début de la connaissance, etc » :+)
Ah, le cercle vertueux de la connaissance et de l’action qui mène aux compétences ! Merci de cet apport philosophique, Didier, que je savoure, n’ayant pas su si bien dire moi-même.
«Si on mettait autant d’énergie à construire la réforme qu’à la démolir, nous aurions contribué au progrès plutôt qu’à la stagnation.»
Si on mettait moins d’énergie à « chiâler », effectivement on avancerait bien plus vite !
Ceci se vérifie dans à peu près tout.
M. Sylvain,
Bien sûr, bien sûr, arrêtons de chiâler! C’est tout naturellement la faute des chiâleux si la réforme ne marche pas. C’est même la faute des profs (dixit Perrenoud), des syndicats (dixit Bisaillon) mais, surtout, il ne faut pas se remettre en question.
Je suis désolé, M. Sylvain, mais je n’ai pas envie de faire un pas en avant quand je suis au bord du précipice. Avancer plus vite quand on ne sait pas ou l’on va ne me mènera pas à bon port pour autant.
La réforme, je la critique en me rappelant toujours l’élève: saura-t-il mieux lire, écrire et parler? Et , pour l’instant, la réponse est non.
Et à ceux qui me disent qu’il faut laisser le temps à la réforme de faire ses preuves, je répondrai ceci: ah bon! votre système n’est plus aussi miraculeux que vous le disiez? Les enfants, ça ne vous dérange pas trop de les plonger dans une expérimentation de la sorte?
J’écris expérimentation par politesse, car, dans mon esprit, on n’est pas loin de l’improvisation… Un hôpital agirait de la sorte avec ses patients et on hurlerait au scandale.
Nos gestionnaires pédagogiques ont des responsabilités sociales et humaines qu’ils ne semblent pas prendre en compte. Un exemple: le bulletin de la réforme que le ministre a promis de réformer en deuxième secondaire ne sera pas fait avant l’an prochain. On garde donc pour un an un bulletin que tous jugent mauvais ou inefficace en attendant l’année prochaine… Un autre exemple: le bialn de la réforme promis en avril 2006 par le ministre est sorti en juin 2006 et était incomplet… Les propositions de la Table de pilotage remettent tellement de choses en question que c’en est effrayant quand on y pense…
Je vous signale, parce qu’on ne le dit pas assez, que ce type d’enseignement n’a jamais passé la barre du secondaire en Suisse parce qu’on a compris là-bas que c’était un véritable casse-tête ou un véritable casse-gueule. Mais au Québec, pays du formidable et du merveilleux, on est toujours meilleur qu’ailleurs. On brille parmi les meilleurs. On va ça dans les tests internationaux de nos ti-pits du primaire depuis un bout de temps.
Alors, je me demande pourquoi tout cet argent, toutes ces énergies pour changer quelque chose pour une autre qui ne marche finalement pas mieux.
Depuis 40 ans, au Québec, c’est le même ministère et les mêmes fonctionnaires qui nous proposent réforme sur réforme. Ils nous imposent des nouveaux modes d’enseignement pour remplacer ceux qui sont soi-disants déficients et dont ils nous ont pourtant vanté les vertus dix ans plus tôt.
Je suis désolé, mais je ne rachète pas une voiture usagée chez un concessionnaire qui m’a refilé un citron. Ceux qui nous apportent le renouveau pédagogique aujourd’hui sont les mêmes qui nous ont vendu hier un système scolaire qu’ils veulent changer parce qu’il serait mauvais. Question de crédibilité, de confiance. Question de professionnalisme.
J’ai une pensée critique, c’est vrai. Mais je préfère cela à la pensée magique.
Je ne peux qu’être en accord avec les propos de monsieur Papineau.
Soyons réaliste et posons un regard sur cette réforme à partir des faits, des commentaires des profs qui vivent cette réforme et non de l’illusion. Ceux-ci ont répondu à plusieurs reprises par le bais de différents sondages = ça ne marche pas !
Comment maintenir une réforme lorsque ceux qui ont pour mandat de l’appliquer affirment majoritairement qu’elle ne fonctionne pas !
Loin de moi l’idée de dénoncer ceux qui critiquent, qui ont des arguments et qui veulent bâtir ! Ce que je dénonce, ce sont les pertes d’énergie qu’occasionnent les « chiâlages » inutiles. Il y a toute une marge entre chiâler pour chiâler et critiquer dans le but de construire quelque chose, que ce soit l’éducation ou n’importe quoi d’autre dans la vie.
D’ailleurs, M. Papineau, loin de moi l’idée de sauter dans un train si je ne sais pas où il va… J’aime bien réfléchir avant d’agir et connaître ce qui motivera mon agir. Mais il faut reconnaître par la même occasion qu’il y a dans tout système (éducation comme ailleurs) des chiâleux qui paralysent ou ralentissent des trains. Ceux-là n’ont pas d’argument autre qu’une résistance certaine aux changements de toutes sortes. Ce sont ceux-là que je dénonce, pas ceux qui posent des questions intelligentes et permettent de faire évoluer la réflexion ! La pensée magique, non merci pour moi aussi.
Alors je suis désolé que, selon vos propos ci-dessus, vous vous soyiez senti visé par le qualificatif de « chiâleux »…
Il appert que l’on s’éloigne encore une fois du sujet premier du billet. C’est comme si la seule mention de « réforme » sonnait le début d’un round de boxe.
J’aimerais préciser que plusieurs professeurs, dont Sylvain et moi-même, enseignons très bien à partir de l’esprit de la réforme, et que les élèves réussissent très bien. À ce que je sache, ce n’est pas une « illusion ».
Ne mêlons pas les pommes et les oranges. Il faut savoir distinguer les théories qui sous-tendent la réforme, d’une part, et son implantation par les gestionnaires, d’autre part.
Sur le plan de la théorie, il est évident que l’uniformité est indéfendable. Il revient au professionnel de déterminer la méthode pédagogique qui convient aux intentions d’apprentissage et aux besoins des élèves. La pluralité des méthodes et la liberté professionnelle sont de mise. Évitons surtout de tomber dans la tyrannie de la majorité.
Quant à l’implantation de la réforme, je suis aussi enragé que quiconque du fiasco dans lequel on nous a garrochés. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas chercher à améliorer la situation.
M. Guité,
Il est bien clair que la réforme déchaîne les passions. En fait, le renouveau pédagogique a connu bien des dérives et des difficultés d’implantation qui ne peuvent que susciter des débats enflammés. Et je suis enragé maintenant qu’on commmence sournoisement à accuser les enseignants de l’échec de celle-ci alors qu’avec les élèves, nous travaillons tous à la réussite de ces derniers.
Le problème, pour moi, réside dans l’évaluation. Je crois qu’on a compris qu’il fallait laisser de la latitude aux enseignants quant aux méthodes pédagogiques contrairement au début de la réforme ou les zélotes du Renouveau me disaient que j’étais rien de moins qu’un criminel parce que je donnais un examen à choix de réponses à mes élèves. De toute façon, même avec le système actuel, j’en prenais, de la latitude, parce que je suis un professionnel qui est capable de se remettre en question.
L’évaluation comprend ce qu’on veut évaluer et les contextes d’évaluation. Or, l’évaluation des compétences transversales est un vrai casse-tête dans une école secondaire de 2 000 élèves. De plus, les critères d’évaluation sont flous et laxistes (l’ancien sytème était moins flou, mais tout aussi laxiste, je le souligne). La différenciation pédagogique, le porte-folio, les parcours académiques en 3e, 4e et 5e secondaires sont autant de concepts qui ne tiendront pas la route, je crois.
Voilà pourquoi j’ai de la difficulté à travailler à trouver des solutions au renouveau. J’ai l’impression de passer mon temps à «améliorer le problème» au lieu de le règler. Le «patchage» de routes académiques n’est pas une solution quant à moi.
L’évaluation constitue effectivement un fichu merdier dont on n’a pas fini d’entendre parler. Loin de moi l’idée de vouloir jeter la pierre à quelconque enseignant (car je sais trop bien dans quelles conditions difficiles nous travaillons), mais si je peux exprimer un avis, l’évaluation (du moins celle qu’on entend généralement comme administrative) est le venin qui paralyse l’éducation.
J’ajouterais François que l’évaluation actuellement, c’est la queue qui fait branler le chien. J’ai un peu d’études en technologie éducative derrière la cravate. Si demain, à titre de consultant, la NASA me demandait de monter un cours de pilotage pour une navette spatiale, la règle de l’art me commanderait de d’abord me demander ce que je veux obtenir à la fin en terme de compétences et de le définir en termes clairs, opérationnels. Ensuite, je devrai statuer sur la façon dont j’évaluerai ce résultats et me donner des indicateurs. Ce n’est qu’après avoir fait ce travail, que je m’attellerai à choisir une stratégie d’enseignement et développer des outils et des situations d’apprentissage. C’est ce qu’on appelle du « upfront planning ». Je ne sais pas le terme français. Peut-être « planification à rebours »? Visiblement ce n’est pas la voie qu’a empruntée le renouveau.
J’ai quand même lu ailleurs François, que vous partagiez sensiblement le même point de vue que moi sur la liberté pédagogique et le potentiel réel d’initiative des éducateurs. À toutes les époques de ma carrière, je me suis senti responsable des résultats obtenus par mes élèves. J’ai toujours reconnu ma part de responsabilité, pour les échecs comme pour les succès.Cela a toujours alimenté chez moi le goût, l’obligation, de chercher plus, essayer plus, faire autrement. J’ai blâmé déjà le système, et je le fais encore à l’occasion, pour ne pas m’avoir toujours fourni les meilleures conditions d’hygiène: qualité des locaux, disponibilité du matériel, des ressources pour la formation, et le reste. Mais jamais pour ma propre difficulté à faire progresser un jeune. Un collègue à moi est enseignant en 5e secondaire. Il a sauté les plombs l’autre jour en entendant un autre collègue à lui, au même niveau, blâmer le réforme pour l’échec de ses élèves en mathématiques, alors qu’aucun des élèves de cette cohorte n’avait mis les pieds dans une classe « réformée ». Il y a tellement de chose sur lesquelles nous n’avons malheureusement que peu de prise, concentrons l’essentiel de nos énergies pour agir là où nous avons les marges de manoeuvre. Non ?
« [...]me demander ce que je veux obtenir à la fin en terme de compétences et de le définir en termes clairs, opérationnels. Ensuite, je devrai statuer sur la façon dont j’évaluerai ce résultats et me donner des indicateurs. »
Intéressant. Les attentes de fin de cycle sont bien définis dans le programme. De plus, les indicateurs sont les critères d’évaluation, qui sont, eux aussi, très bien définis dans le programme. Je crois d’ailleurs que c’est la première que des critères d’évaluation soient prescriptifs.
Bien entendu, tout cela est perfectible et peut-être y a-t-il lieu de préciser ou de réécrire certaines attentes ou certains critères.
« Cela a toujours alimenté chez moi le goût, l’obligation, de chercher plus, essayer plus, faire autrement. »
d’où Wang Yang Ming :+)))
Parce que pour le praticien, les modèles épistémologiques ne sont pas la porte d’entrée…
Il y a une question fondatrice de l’enseignant: quelles sont les limites à l’explication ?
« Voici par exemple un livre entre les mains de l’élève. Ce livre est composé d’un ensemble de raisonnements destinés à faire comprendre une matière à l’élève. Mais voici maintenant le maître qui prend la parole pour expliquer le livre. II fait un ensemble de raisonnements pour expliquer l’ensemble de raisonnements que constitue le livre. Mais pourquoi celui-ci a-t-il besoin d’un tel secours ? Au lieu de payer un explicateur, le père de famille ne pourrait-il pas simplement donner le livre à son fils et l’enfant comprendre directement les raisonnements du livre ? Et s’il ne les comprend pas, pourquoi comprendrait-il davantage les raisonnements qui lui expliqueront ce qu’il n’a pas compris ? Ceux-ci sont-ils d’une autre nature ? Et ne faudra-t-il pas dans ce cas expliquer encore la façon de les comprendre ? »
Voir: http://www.destatte.be/dotclear/index.php?2006/04/25/309-regards-sur-les-methodologies-joseph-jacotot-1770-1840
Il ne s’agit donc pas a-priori d’une adhésion à des pédagogies « nouvelles », à des réformes, à un modèle d’apprentissage. Il s’agit d’élargir la palette des méthodes, parce que l’on sait, surtout pour les plus fragiles, que le savoir rend libre.
Si l’on considère que l’explication se suffit au delà de la personne qui apprend, alors, évidemment – mais de surcroît, par effet collatéral – on induit également une vision du monde où l’homme serait non seulement subordonné aux savoirs, ce que l’on sait, mais surtout à une « norme » de transmission.
Toutes les personnes que je rencontre et qui sont porteuse d’approches actives en éducation considèrent avant tout que l’éducation est un droit et que ce droit ne doit pas être diminué par une autosatisfaction de l’éducateur. C’est avant-tout une pédagogie du doute.
Mais tout cela est très proche de Bourdieu et des travaux de Pourtois (http://w3.umh.ac.be/pourtois/) qui sont effectués dans ma région.
Pour ce qui est des évaluations, moi je priviligierais un système interactif. On composerait simultanément les référentiels de compétences; les référentiels de savoirs, les programmes et les évalations. Cela permettrait de garder une cohérence entre chaque niveau. Cela constitue également un procédé de régulation et de clarification efficace. Ce serait un beau projet, à l’ère des évaluations internationales, d’ élaborer un wiki de transposition didactique ;+)
Au primaire, en 6e année, un élève qui écrit un texte de 250 mots avec 250 fautes de grammaire et d’orthographe peut, malgré tout, réussir son évaluation.
Les attentes, quant à l’écriture au primaire, sont définies, ne sont pas toujours claires (dans les descriptifs d’appréciation pour guider les enseignants dans leur évaluation, on emploie des termes comme parfois, souvent, quelques fois, à l’occasion..), mais sont-elles assez exigeantes?
Qu’on se console, il en était de même avant la réforme ou les critères étaient également prescriptifs. Seulement, tant qu’à changer, aurait-on pu demander un peu plus de notre système d’éducation et de nos élèves?
« Au primaire, en 6e année, un élève qui écrit un texte de 250 mots avec 250 fautes de grammaire et d’orthographe peut, malgré tout, réussir son évaluation. »
Mais de quelle évaluation parlez-vous?
Pour juger d’une compétence, l’enseignant ne doit pas, à mon avis, se fier à UNE évaluation.
Si vous parlez de l’examen du ministère de fin d’année, il n’est EN AUCUN CAS, celui qui indique si l’élève « passe ou non ». Cette évaluation fait partie du jugement de l’enseignant comme le sont les autres pièces du portfolio du jeune.
L’idée d’une seule évaluation finale pour juger d’une compétence est à rejeter, à mon avis.
Posons alors la question clairement:
Pour vous, M Jobin, grand amateur de lecture et de littérature, estimez-vous qu’un enfant qui écrit une faute de grammaire ou d’orthographe par mot dans un texte devrait passer du primaire au secondaire?
Ah ! M. Papineau, vous n’aimez tellement répondre aux questions, n’est-ce pas?
M’enfin, je répondrai à la vôtre, selon ma conception du programme.
Il y continuité entre le primaire et le secondaire, comme il y a continuité entre le premier cycle et le deuxième, le deuxième et le troisième (du primaire).
Ce n’est qu’après de premier cycle du secondaire qu’il y a des parcours différents. Mais avant cela, on essaie tous d’amener les élèves le plus loin possible.
Quant à cet enfant qui est si moche en français, je suppose qu’il a sans doute un plan d’intervention depuis des années, et qu’on continue à l’aider malgré ses difficultés. Les profs du secondaire, en continuité je le répète, feront donc avec ce plan, comme ils peuvent, dans la mesure de leurs moyens. (C’est là le problème : il faut bien entendu augmenter les ressources, si on veut être logique : aider cet enfant noyé dans un classe de 32 élèves est tout à fait ridicule… )
Voir le secondaire séparé du primaire n’a plus raison d’être, d’après ce que j’ai compris du PDFEQ.
Il faut distinguer ce que le programme même dit, d’avec ce qu’il faut pour l’implanter correctement.
M. Jobin,
Pour répondre à votre question, à laquelle vous aviez vous-même déjà répondu, il s’agit de l’évaluation de fin de sixiène année du primaire. Voilà qui est fait!
Pour l’essentiel de ce billet, j’aimerais revenir sur votre argumentation théorique et l’inscrire dans un contexte de réalité.
Donc, selon votre raisonnement, pendant huit ans (six années du primaire et deux du secondaire), on doit tenter d’amener l’élève le plus loin possible. Ça fait un gros cycle d’études. Donc, le «tri social» va s’effectuer à la fin du deuxième secondaire avec une évaluation ou une appréciation qui ne «triera» rien, croyez-moi. L’élève pourra toujours faire autant de fautes qu’il y a de mots dans ses textes et réussir.
Pendant au moins huit ans (en fait, dix ans si l’on comprend que le gamin pourra poursuivre son parcours académique en 3e et 4e année du secondaire), ce jeune n’aura jamais reçu un signal clair de ses difficultés en écriture, n’aura accès à aucune ressource et continuera son petit bonhomme de chemin dans un système qui se ferme les yeux.
Il arrivera fatalement en cinquième secondaire ou, là, un méchant enseignant lui expliquera que la norme veut qu’il ne fasse pas plus de 35 fautes de grammaire et d’orthographe pour un texte d’environ 500 mots.
J’ai annoncé cette bonne nouvelle à mes élèves récemment. Ils ont hurlé de rage. Premièrement, ils ont eu l’impression qu’on leur a menti pendant des années à propos de leur réussite en français. Deuxièmement, ils se sont découragés en se disant qu’ils n’arriveraient jamais à atteindre le seuil fixé parce qu’ils avaient dix années à rattraper. Découragés aussi parce qu’il est difficile pour eux de réaliser des apprentissages s’ils ne comprennent rien depuis des années. Ils ne sont pas bêtes et c’est pour cela que je les aime. On va donc travailler comme des forcenés en espérant…
Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que les jeunes québécois soient plus faibles en ce qui a trait à la langue dans diverses études internationales!
Parce qu’il est là, le problème: vous dites qu’on laisse du temps pour amener les élèves plus loin. En fait, ce temps joue contre eux. Pendant des années, le système – réforme ou pas réforme -tolère leurs insuffisances en écriture et, quand vient le temps de les confronter à une norme de réussite acceptable, il est trop tard. On a laissé le patient mourir à petit feu, faute de soin parce qu’on s’imaginait qu’il guérirait seul ou avec une aide qui était tout bonnement inappropriée ou inexistante.
L’enfant dont je vous parle, M. Jobin, n’est pas une exception, je vous prie de me croire. Il n’a pas de plan d’intervention puisque, pendant huit longues années, il réussit. N’est-ce pas ironique? Cet enfant n’existe tout simplement pas officiellement!
L’enseignant doit donc l’aider du mieux possible en tenant compte du fait que l’élève ne peut bénéficier de ressources et qu’il n’est pas le seul de sa classe. Même qu’il commence à avoir beaucoup de semblables. Et la masse critique devient de plus en plus critique. Pour les élèves bien ordinaires inscrits, pas inscrits dans des programmes d’élite, l’enseignement régulier va vers le bas.
Dans la réalité, actuellement, la maîtrise du français écrit des élèves du primaire est à la baisse (C’est le MELS lui-même qui l’affirme). Le nombre de classes pour élèves en difficulté augmente, même si on fait tout pour ne pas en créer. Certains CS intègrent même joyeusement des élèves du niveau de la troisième année du primaire dans deux groupe de deuxième année du secondaire en demandant aux profs de pratiquer la différenciation pédagogique.
Voilà la réalité, Un enfant entre en quatrième secondaire en ne sachant pas reconnaître un verbe d’un nom, en écrivant autant de fautes que de mots et en éprouvant des difficultés de lecture importantes.
Au-delà de la théorie, il y a la pratique. L’ancien système comportait des failles importantes. La réforme, loin de les colmater, les ouvre davantage.
Au-delà de la théorie, il y a la réalité. Touvez-vous normal qu’autant d’élèves maîtrisent si mal leur langue maternelle après 11 années d’études? À l’examen de fin de cinquième secondaire, l’élève pourra faire une faute aux 15 mots et réussir. Est-ce acceptable?
Ces questions semblent claires. De grâce, puis-je émettre le souhait que vos réponses ne soient pas théoriques ou appuyées sur un programme auquel – on le sait tous les deux – on n’a pas donné les moyens de ses ambitions.
Vous aimez lire, vous aimez écrire. Aimeriez-vous être parmi ces élèves dont je parle?
« l’élève pourra faire autant de fautes qu’il y a de mots dans ses textes et réussir. »
Mais où cela est-il écrit???
Pour ce que j’en sais, si l’élève n’a pas réussi certaines compétences en particulier (même s’il réussit les autres), il sera considéré en échec.
« J’ai annoncé cette bonne nouvelle à mes élèves récemment. Ils ont hurlé de rage. Premièrement, ils ont eu l’impression qu’on leur a menti pendant des années à propos de leur réussite en français. »
Si je ne m’abuse, vous enseignez en cinquière secondaire, donc vos élèves NE SONT PAS enfants de la réforme. Vous semblez suggérer qu’avec le renouveau, cela ne sera pas mieux. À lire comment vos élèves semblent poches en ortho, je ne vois pas, pour l’instant, comment ça pourrait être pire!
Mon discours peut vous apparaître théorique. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous expliquer une petite chose : en tant qu’enseignant, on se doit d’appliquer le programme de formation. C’est pour ça qu’on est payés. DONC, il est important de bien le comprendre pour, justement, argumenter auprès des décideurs. Certaines choses nous appartiennent, d’autres appartiennent aux boss.
Je crois donc que si, pour des raisons bien établies, on ne peut développer les compétences chez nos éleves, on se doit d’en avertir notre supérieur immédiat pour qu’il « signe en bas », autrement dit qu’il prenne lui la responsabilité de cette impossibilité. Je pense qu’on a pas à prendre les raté du sytème sur notre dos : il faut que les décideurs ADMETTENT que ce programme, faute de moyens, est impossible à appliquer. Il faut donc apprendre à dire aux parents : « Désolé, je ne peux appliquer le programme de formation. Mon boss est au courant et il cautionne la chose. Si vous voulez chiâler, prennez rendez-vous avec lui. Moi, j’fais mon possible. »
J’oeuvre au niveau des TIC et c’est ce que je suggère aux enseignants : « Puisque tu n’as pas accès à des ordis alors que le développement de certaines compétences le demande, préviens ton patron et les parents que cette transversale sera impossible à développer. » C’est tout.
Théoriquement, je crois que ce programme est très beau. Mais le système d’éducation n’est peut-être pas prêt pour l’accueillir. Si on bourre les classes, je regrette, mais il vaut peut-être mieux à revenir à un programme par objectifs, en se contentant de passer la matière.
Moi, je n’en veux pas à la Réforme, j’en veux au système d’éducation et à ses dirigeants qui manquent complètement de vision. C’est pour cela que je leur demande d’admettre que dans leurs écoles, certaines compétences sont absolument impossible à développer. À eux d’aller voir le DSE, puis le DG. ET à ces derniers de faire admettre la chose par le Ministre. Je ne vois pas comment on peut faire autrement…
« Touvez-vous normal qu’autant d’élèves maîtrisent si mal leur langue maternelle après 11 années d’études? »
Cette question, depuis Montaigne, est récurrente. Faut donc croire que la poser semble bien normal…
Quant à moi, si j’enseignais le français (c’est ce que je faisais comme prof de maths), je tenterais tout en mon pouvoir pour que les élèves deviennent meilleurs. Qu’ils le deviennent ou pas est hors de mon contrôle. Ce travail est difficile, je le sais, mais je ne fais pas partie de ceux qui croient à une méthode miracle en enseignement.
Pour votre toute dernière question, ce n’est pas à l’école que j’ai développé le goût de la lecture. Quant à l’écriture, à part un livre de maths que j’ai publié en 90, je n’y suis venu que très très tard, avec mon blogue. J’ai encore, je le sais, beaucoup à apprendre…
PS. François : désolé si mon message n’est plus en rapport avec ton billet. Ce sera ici mon dernier.
Allons-y par étape et précisons certaines choses.
Tout d’abord, il existe des grilles de correction pour évaluer les textes des élèves du primaire. De même pour les élèves du secondaire. Elles sont fournies par les maisons d’édition, par les CS ou par le MELS. Dans tous les cas, le fait d’écrire une faute d’orthographe ou de grammaire par mot n’empêche pas un élève de réussir un examen, sauf en cinquième secondaire ou un seuil de réussite a été fixé à 35 fautes pour un texte d’environ 500 mots (une faute aux 14 mots: pas de quoi à écrire à sa mère après 11 années d’école).
De plus, dans la réforme, un élève peut échouer une des trois compétences au bulletin en français et être néanmoins promu. Il en va de même avec l’ancien système pour le secondaire, sauf en cinquième ou l’élève doit avoir un minimum de 50% dans chaque volet (lecture, écriture et oral) et un sommaire cumulatif de 60%.
Par la suite, je n’ai pas blâmé la réforme pour cette réalité («Pendant des années, le système – réforme ou pas réforme – tolère leurs insuffisances en écriture»). J’ai indiqué cependant qu’elle aggravait, selon moi, cet état de fait et que toutes ces énergies me semblent futiles si elles ne se traduisent pas par une amélioration de la maîtrise de la langue des élèves. Je suis désolé pour les gens qui peuvent être offensés par de tels propos.
Par ailleurs, mes élèves ne sont pas «poches en ortho». Ce terme est méprisant et je ne l’emploie jamais à l’égard d’un élève. Ils réussissent exactement comme le MELS le leur demande. Ils répondent aux attentes placées en eux, point à la ligne. Pourquoi en feraient-ils plus si cela n’est pas nécessaire parce que le seuil de réussite ou de maîtrise de la langue ne l’exige pas?
La situation pourrait être pire, si cela peut vous inquiéter. Ils pourraient perdre complètement ce qu’est le sens de la phrase, la syntaxe. Déjà, leur ponctuation est souvent aléatoire.
Également, je ne crois pas m’en prendre à vous, mais je discute de la vision que vous avez de l’enseignement en me basant sur une pratique réelle dans une école secondaire bien ordinaire et j’estime que votre regard n’est pas toujours précis. Tout en tenant compte que ce lieu est public et que nos propos sont lus par des internautes qui ne connaissent pas tous le monde de l’éducation aussi bien que nous, je discute en tenant compte de vos propos, je rectifie certains énoncés avec des arguments, des faits tirés de mon quotidien et de ma pratique d’enseignant sur le terrain. La théorie, les programmes de formation, c’est bien beau, mais je vis dans la réalité de mon travail. Que puis-je y faire? Sur papier, dans l’absolu, le Renouveau pédagogique est magnifique tout comme certains articles de la constitution américaine qui traitent du droit à la poursuite du bonheur.
Pour l’instant, un peu à l’image de ce que vous mentionnez, je suis déchiré dans mon enseignement entre «patcher» les incohérences du système parce que les enfants devant moi ont besoin d’aide ou me réfugier dans les limites de mon mandat et arrêter de sauver le monde. Sauf que je travaille avec des enfants, des jeunes, des êtres humains qui pleurent quand ils échouent les tests de cinquième parce qu’ils ne sont pas préparés à les faire. Faut-il que je les sacrifie et que je leur dise: «Allez voir mon boss. Moi, je fais ma tâche!» Mon boss, qu’il soit ministre ou directeur, à travers le temps, n’a pas semblé pas très ému par cette situation de toute façon.
Si j’ai co-écrit un bouquin, c’est justement pour lancer un message sur l’état lamentable de l’enseignement du français au Québec. Réaction du ministre Fournier: ce livre soulève des situations préoccupantes. Mais qui va s’en occuper, je me le demande bien? Nos syndicats, un ordre professionnel, le MELS…
Quant à ma question à savoir s’il normal qu’autant d’élèves maîtrisent si mal leur langue maternelle après 11 années d’études, votre réponse semble suggérer que rien n’a changé malgré les siècles. Est-il normal qu’avec toute notre science, nos avancées pédagogiques, notre éducation démocratique, notre volonté de réussite du plus grand nombre, nous n’ayons pas plus progressé?